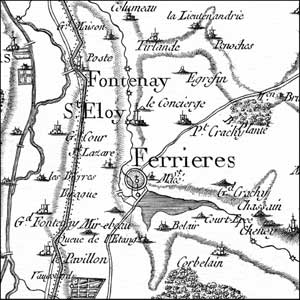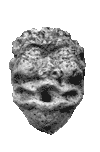|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
accueil |
|
|
|
|
|
|
L'étang
des Moines
Pour se développer dans cette zone marécageuse, où abondaient sources, fontaines
et rivières souterraines et où la rivière la Cléry, incontrôlée, débordait
largement de son lit une partie de l'année, Ferrières a dû, et ceci probablement
très tôt dans son histoire, s'organiser pour se protéger de l'invasion des
eaux, pour en maîtriser les débordements, les canaliser, les domestiquer
afin qu'elles lui fournissent protection, énergie et ressources.
L'état de nos connaissances fait remonter aux moines de l'abbaye les premiers
grands travaux connus de domestication de l'eau, même si rien n'interdit
de penser que des travaux plus primitifs les aient précédés. Ils auraient
consisté à dresser, à l'emplacement de ce qui s'est appelé successivement
Chaussée des Moines, Levée du grand étang , puis boulevard de la Brèche,
une levée de 300 à 400 m de long en pierres de taille, pour barrer l'eau
de la Rivière la Cléry et former un étang ; dans le milieu de cette levée
existe une arche qui traverse la chaussée et qu'on appèle la Bonde ; à cette
arche il y avait une vanne qu'on levait à volonté pour mettre de l'eau dans
le petit étang qui se trouvait au pied des murs d'enceinte de l'Abbaye.
(T. Picard) |
|
|
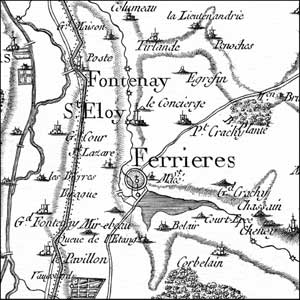 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
L'Etang des moines détail de la carte
de Cassini
|
|
Etang des Moines : la grande bonde
|
|
|
Comme l'explique
T. Picard, cet étang qui commençait au niveau du pont du Gril de Corbelin,
à Griselles et allait jusqu'au lieudit la Queue de l'étang avait été construit
pour au moins deux sinon trois raisons. La première était de réguler le
cours de la Cléry en période de crue et de protéger l'abbaye et le village
de ses débordements. La deuxième était de disposer d'une importante réserve
d'eau qui permettait, en ouvrant les vannes de la bonde, d'inonder à volonté,
en cas de danger, les terres situées en aval, le long de la rivière jusqu'au
moulin de Saint-Eloi, constituant ainsi une protection naturelle sur le
côté de la ville qui n'était pas protégé de murs d'enceinte. La troisième
enfin, était de fournir, grâce à la pêche, une ressource vivrière importante
permettant de nourrir la communauté monastique et d'apporter un revenu substantiel
à l'abbaye.
Faisant le pendant de cet étang, dit supérieur, situé en amont de la levée,
les textes anciens font état, de l'autre côté de la levée, d'un petit étang,
alimenté par les nombreuses sources et fontaines ferrugineuses auxquelles
il est fait également référence dans ces textes et auxquelles on attribuait
de grandes vertus, ce qui valut à Ferrières une certaine réputation et d'illustres
visites. Du jardin de l'abbé, on accédait à ce petit étang, qui correspond,
selon toutes vraisemblances à une petite pièce d'eau qui existe encore dans
le parc de l'une des propriétés privées situées le long du boulevard de
la Brèche. C'est l'ensemble de cette zone située en contrebas de la levée
et des remparts, incluant le petit étang et la Cléry qui devait être inondée
en période de danger.
L'étang supérieur, fut parfois l'objet, entre les Ferriérois et l'abbé,
d'âpres disputes et de procès à propos de droits de pêche, de la faculté
de laisser abreuver les bestiaux à la rivière qui traversait l'étang et
de pacage sur le sol de l'étang lorsque celui-ci fut asséché dans les années
1771-72. On trouve également trace dans les archives municipales des problèmes
posés par l'entretien et la réfection de la chaussée des moines que la pression
des eaux faisait s'effondrer, notamment à la suite des grandes crues. |
|
|
|
Étang de Ferrières : dessèchement
L'inondation de 1770 donna aux bénédictins l'idée du
déssèchement de l'étang de Ferrières.
Ils obtinrent du Conseil d'Etat la permission de dessécher le
dit étang, et sa majesté commit la maitrise des eaux et forets
de Montargis pour informer de commodo et incommodo du déssèchement
demandé. Ce procès verbal est du 12 octobre et jours suivants
1771 ou 1772.
La municipalité de Ferrières fut appelée à cette enquête et il
fut stipulé que les Abbés et religieux laisseraient aux habitants
de Ferrières la faculté d'abreuver leurs bestiaux à la rivière
qui traversait l'étang, le libre usage du pacage comme ils avaient
toujours joui, et comme la coutume de Lorris, Montargis, qui régit
le sol du dit étang, le leur accorde en telle nature et qualité
qu'il fut converti.
Ces droits ont été reconnus par les Bénédictins, en la personne
de Dom Delandre, au procès verbal de commodo et incommodo.
Mais il s'en suivit procès soutenu par le sieur Abbé Onic et religieux
qui réduisirent à néant les réclamations des Ferriérains en se
rendant opposants en parlement 1775-1776
(T. Picard chap. 21 p.5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Après cette
date, les archives municipales font fréquemment état de travaux ou de projets
de travaux de curage et d'aménagement touchant aux rivières de la Cléry
et de la Gobine ou à la protection contre les crues récurrentes : ainsi,
en 1831, on parle de "dégradations majeures dues aux débordements des eaux
au glacis construit au lieu-dit de la Brèche" ; en 1833, projet d'un pont
pour remplacer un gué en ville ; en 1858, projet de petit canal entre le
pont de la Brèche et le Perray ; en 1863, curage de la Cléry ; en 1894,
réaménagement du pont sur la Gobine aux Martinets pour optimiser les crues
après le curage de la rivière etc. En revanche, en l'absence de toute référence
à l'étang dans les archives municipales après 1772, on peut légitimement
penser que celui-ci n'a pas été vraiment remis en eau après son assèchement
: tout au plus a-t-il pu servir de déversoir occasionnel lors des inondations
hivernales. En 1838, il est fait état de "curage au-dessous de la chaussée
de l'ancien étang" […] "à charge des propriétaires des terres de l'ancien
étang qui seront juges de profiter de ce curage." Il apparaît donc
qu'à cette date non seulement l'étang était à sec depuis un certain temps,
mais que les terres libérées avaient été au moins en partie vendues à des
particuliers.
Aujourd'hui, l'étang des moines ne subsiste plus que dans la toponymie :
tout récemment, la municipalité a fait aménager un parcours sportif sur
le terrain qui lui appartient, en contrebas de l'ancienne chaussée des moines,
mais il arrive qu'en hiver les eaux fassent à nouveau valoir leurs droits
sur cet espace qui reste naturellement soumis à leurs caprices. |
|
|
|
La fontaine ferrugineuse
La fontaine ferrugineuse est située dans un Clos dit
le jardin abbatial, qui n'est autre chose qu'un véritable marais
quoi que entouré de murs; cette fontaine minérale est au midy
de la ville, elle sourde d'une petite montagne qui est au couchant,
tous les fossés et les petits courants d'eau dans lesquels elle
tombe sont couverts de rouille et d'une pellicule assez épaisse,
grasse et gazeuse ; […] je puis assurer que ces eaux minérales
sont un puissant tonique, un excellent apéritif, un très bon désobstruant
& . […] Cette fontaine jouit de tems immémorial de la plus grande
célébrité ; j'ay vu dans mon bas âge quantité d'étrangers qui
venoient à Ferrières prendre les eaux aux deux saisons et qui
s'en retournoient fort contents. Il y en a bien encore qui y viennent
mais ce sont des malades de la province ou de ses confins. Il
est bon d'observer que l'air de Ferrières est vif, pur et très
sain, que les environs de la ville sont rians ; les coupes diversifiées
et fort agréables, ce qui ajoute beaucoup à l'usage des eaux et
les rend d'autant plus salutaires.
R.G. Gastellier, Essai topographique, minéralogique, historique
de la province du Gatinois, in B.S.E.M. n°106 ; p.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les trois platanes
Située hors la ville, au-delà de l'ancien étang des Moines,
cette zone humide et non construite a longtemps servi de réceptacle
pour les résidus d'ateliers de la ville (tanneries et alambic
en particulier). Selon la tradition, en 1870, trois Prussiens
y auraient été tués et ensevelis. Sépulture provisoire, dont le
souvenir est perpétué par les trois platanes plantés au centre
du carrefour.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
chapelle Saint-Lazare
A la sortie de la ville en direction de Fontenay, au sommet de la côte
du même nom, sur la gauche, se dresse une ancienne chapelle romane qui appartenait
à la maladrerie de Saint-Lazare de Ferrières, dont les biens et revenus
ont été réunis à la maison de charité de la ville par lettres patentes de
Louis XIV accordées à Fontainebleau en 1693.
Réservée aux "pensionnaires" de la maladrerie, cette chapelle s'ouvrait
aussi, en certaines occasions, à un public plus vaste : le curé de la paroisse
y officiait les jours de la Saint Hubert, de la Saint Barnabé et de la Saint
Eloi. |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
La chapelle,
de style roman, a été vendue, comme les bâtiments de l'abbaye, au moment
de la Révolution. Désaffectée, mais non démolie, elle a servi de grange
et abrite aujourd'hui un magasin d'antiquités. Des percements divers ont
modifié l'aspect de la façade côté sud ; l'ouverture des chaussées qui l'environnent
et les travaux de terrassement effectués à cette occasion ont fait apparaître
les soubassements des murs et la partie haute des fondations et transformé
en fenêtres des portes d'autrefois. Mais l'ensemble de l'édifice conserve
ses caractéristiques essentielles. L'intérieur est particulièrement intéressant
: la voûte romane de l'abside était autrefois entièrement décorée de peintures
murales dont il reste des vestiges importants.
Outre la chapelle, certains bâtiments subsistent de l'autre côté de la route
: une maison, dont la façade crépie montre encore les traces d'un arc, et
porte, gravée dans le haut, la date de 1490. Chapelle et maladrerie étaient
à l'origine réunies sur la hauteur dominant la ville ; l'urbanisation moderne
et les travaux de voirie (route allant rejoindre celle de Paris à Lyon -
N7 - achevée en 1848) les ont séparées. |
|
|
|
Le biquin d'or
Dans certains parlers du nord de la Loire, le mot "bique", sans
doute d'origine germanique, désigne la chèvre ; le biquin
(ou biquet) est une petite chèvre ; par extension, le terme
désigne aussi la bourse, qui peut être en peau de chèvre…
A Ferrières, la rue du Biquin d'or évoque une légende que la tradition
transmet avec quelques variantes. La plus édifiante est liée à
l'histoire de l'abbaye ; la voici :
On raconte que, vers 1220, Blanche
de Castille, mère de saint Louis, qui venait
souvent à Ferrières, perdit sa bourse, son biquin d'or, en se
promenant dans la campagne. Un voleur le retrouva mais ne le rendit
pas. On dit aussi qu'il fut puni. Or, si, à minuit, le soir de
Noël, vous retrouvez ce biquin d'or, la terre s'entrouvre à l'endroit
précis où il fut perdu, et dans le gouffre ainsi ouvert, vous
pouvez voir le voleur brûler dans l'enfer.
Une autre, sans doute plus profane, évoque des échos d'un passé
plus lointain :
Il y a quelque part, entre les hauts de Birague et la rivière,
sur le chemin, un biquin d'or. Qui le découvre est assuré de son
bonheur et de sa fortune pour toute l'année. Or, le seul moment
où on peut le voir, c'est à Noël au moment des trois coups de
la messe de minuit. : la terre s'entrouvre et le biquin brille.
Mais il faut faire vite pour l'attraper.
Il faut donc se damner (puisqu'on n'assiste pas à la messe) pour
être riche.
Cette variante révèle les racines celtiques de la légende, en
relation avec la toponymie et les anciens cultes. Le biquin est
une petite chèvre, animal cornu comme le diable. Et qui a précédé
le diable ? Cernunnos, le dieu cornu gaulois qui dispense richesse
et avoir.
D'autre part, c'est une histoire en rapport avec l'eau. Au-delà
de Birague (dans le parler local, une "birette" est un revenant),
se trouve la vallée Minet, frontière entre Ferrières et Fontenay.
De tradition orale, il s'y trouvait une haute borne, que l'on
peut associer aux "Pierres de Minuit", nombreuses dans le Senonnais
et dont la légende dit qu'elles vont boire à la rivière pendant
la messe le 25 décembre…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
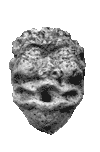 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |