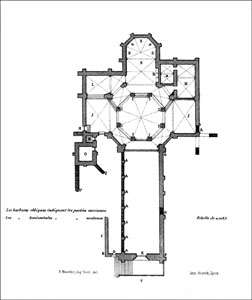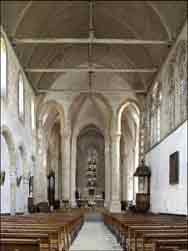|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
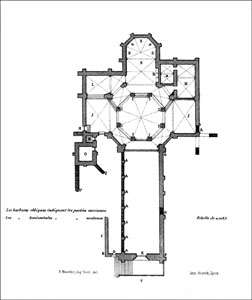 |
|
|
|
|
|
|
|
La seconde
église de la place, la plus imposante, est l'église abbatiale. C'est le
bâtiment le plus important du monastère, celui auquel les moines apportent
le plus de soins car ils y accomplissent leur mission : prier Dieu pour
le salut des âmes.
Plan
interactif de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul ==> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelques
chiffres :
Longueur de l'abbatiale : 60 m
Largeur de la nef principale : 10 m
Longueur du transept : 29 m
Largeur du transept : 9 m
La coupole du chœur : 12 m de diamètre et 16 m de hauteur
Hauteur du clocher : 40 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D'après
Edmond Michel, Monuments religieux, civils et militaires du Gâtinais du
XIe au XVIIIe siècle, Orléans, H. Herluison, pl.IV |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
plupart des éléments de la façade ouest datent de la reconstruction décidée
par l'abbé Amaury, au XIIe siècle.
A gauche, à environ deux mètres de hauteur, on remarque une ancienne ouverture,
aujourd'hui bouchée : la porte
papale. Cette porte s'ouvrait sur le bas-côté détruit après la
chute du clocher en 1739 ; un escalier aujourd'hui disparu permettait sans
doute d'y accéder. Comme son nom l'indique, elle était réservée au souverain
pontife : quatre fois dans l'histoire de l'abbaye, le souverain pontife
a pénétré dans l'église par cette porte, quatre fois elle a été murée, après
son départ, par un appareil de pierres comme on le voit ici. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La porte papale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Des papes en visite à l'abbaye
Grégoire II, selon Dom Morin, serait venu à Ferrières et
y aurait signé une bulle "par laquelle ledict sainct pape donna
plusieurs beaux droicts aux Abbés et religieux de nostre monastère".
Calixte II s'arrête à Ferrières en se rendant au Concile
de Reims le 5 octobre 1119. Sa visite est rapportée en ces termes
par Jarossay : Ce fut évidemment un beau jour pour l'abbaye,
que celui où le pape Calixte II, entouré d'une foule de cardinaux,
d'évêques et d'abbés, y fit son entrée solennelle. La paisible
petite ville gâtinaise était sortie en cette circonstance de son
calme habituel ; une grande animation régnait dans ses rues et
débordait jusqu'en dehors de ses murailles. La multitude accourue
des contrées environnantes fut témoin d'un spectacle à la fois
grandiose et touchant. Le roi de France, Louis le Gros, la reine
Adélaïde, accompagnés de nombreux seigneurs couverts de leurs
plus somptueux vêtements, entrèrent dans Ferrières peu après le
pape. Quand ils l'eurent rejoint, tous le saluèrent avec respect
; le roi, inclinant son front couronné devant la majesté du successeur
de saint Pierre, lui baisa les pieds et lui demanda d'agréer les
sentiments de sa vive affection pour sa personne et, pour l'Eglise,
son dévouement sans bornes. (pp.169-170)
Alexandre III. Obligé de quitter Rome pour fuir les persécutions
de Frédéric Barberousse, il s'était réfugié à Sens. Il vint à
Ferrières le 28 septembre 1163 pour consacrer la nouvelle basilique
Saint Pierre. Il y fit son entrée avec une brillante escorte
de cardinaux, d'archevêques et d'évêques, de princes et de seigneurs,
d'une multitude d'abbés, de prêtres et de clercs. La foule des
pèlerins accourus de tous côtés fut si grande que le nombre des
mangeants et des beuvants se monta à plus de 20000 ; de l'église,
trop étroite pour les contenir, ils refluaient sur les places
voisines et dans les rues de la ville. (Jarossay, page 203).
La cérémonie eut lieu le lendemain, jour de la Saint-Michel :
pour commémorer l'événement, le pape promulgua une bulle par laquelle
il accordait une indulgence d'un an et quarante jours à tous ceux
qui viendraient prier dans l'église à l'anniversaire de sa dédicace
et se feraient inscrire à la confrérie de N.-D. de Bethléem. En
outre, une foire fut établie à la même date.
Innocent IV est le dernier pape à avoir visité Ferrières.
Il y vint au cours de son long séjour à Lyon, en 1247, et fut
reçu avec les honneurs accoutumés. Il entra dans l'église par
la porte papale, ouverte à cette fin. Après son départ, on rebâtit
le mur selon la tradition et la porte ne fut plus jamais ouverte
depuis lors.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La papesse Jeanne à l'abbaye de
Ferrières ?
Selon une tradition qui apparaît en Europe au
XIIIe siècle, l'abbaye de Ferrières aurait été le cadre d'événements
certes controversés mais régulièrement évoqués jusqu'à nos jours.
Vers 1290, le bénédictin Geoffroy de Courlon, suivant Martin le
Polonais, rapporte, dans sa Chronique de Saint-Pierre-le-Vif
de Sens, l'histoire de la papesse Jeanne.
Le mythe repose sur un contresens : l'inscription PPPPPP relevée
à Rome sur le socle d'une statue de Junon allaitant Hercule, qui
signifie Papirius Patri Patrum Propria Pecunia Posuit (Papirius
l'a érigée de ses propres deniers pour le Père des Pères)
a été traduite de façon erronée par le pape père des pères
révélé comme papesse par son accouchement. A partir de là,
ce mythe s'est répandu et a été diversement exploité selon les
époques et les aléas de la politique.
L'histoire raconte que, fille d'un prêtre anglais installé à Mayence
en Allemagne, Jeanne reçut de son père une éducation si complète
qu'à douze ans, son instruction égalait celle des hommes les plus
distingués du Palatinat. Refusant la vie qui lui était normalement
promise, égarée, par un amour interdit pour un jeune escolier
de l'abbaye de Fulda, elle prit des habits d'homme, changea son
nom pour celui de Jean l'Anglais et fut reçue dans la célèbre
abbaye ; elle y suivit les leçons de Raban Maur. Puis Jeanne résolut
de visiter plusieurs pays pour compléter sa connaissance des moeurs,
des langues et des grands textes sacrés et profanes.
C'est au cours de ces voyages qu'elle aurait rencontré Loup Servat.
Admirant les qualités intellectuelles et le grand savoir du jeune
"moine", l'abbé de Ferrières l'aurait invitée dans son abbaye,
où, selon certains, elle demeura deux ans, travaillant dans le
scriptorium et la bibliothèque, jouant même un rôle diplomatique
de conseiller et d'ambassadeur de l'abbé…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
droite de l'ouverture, un des rares chapiteaux historiés de l'abbatiale
représente le légendaire combat de Pépin le Bref contre le lion : lors d'un
séjour à l'abbaye, avec sa cour, alors qu'il assistait à un combat opposant
des bêtes sauvages, le roi aurait jeté dans l'arène la chaussure de la reine,
Berthe aux grands pieds ; puis il se serait écrié : "Qui va chercher la
chaussure de votre souveraine ?" Comme personne n'osait s'y risquer, il
s'élança, dit-on, et aurait tué soit un lion, soit un lion et un taureau,
démontrant ainsi que, malgré sa petite taille, il avait bien la force et
le courage d'un roi. Sur le chapiteau, le roi, coiffé de sa couronne, porte
le coup fatal au lion qu'il tient par les pattes avant. De l'autre côté
de la bête, se trouve un personnage en habit religieux, probablement l'abbé
présent lors du combat. |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Combat de Pépin contre
le lion
Chapiteau de la porte papale
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
En
haut des marches, le portail frappe par sa simplicité. L'emplacement
du tympan détruit pendant la Révolution et maçonné depuis y est pour quelque
chose. Auparavant, selon Dom Morin, on pouvait voir sculpté en relief dans
la pierre, un portrait de Clovis à cheval, portant sur sa main l'image de
l'église, un peu comme sur le vitrail du chœur de Notre-Dame de Bethléem,
accompagné de l'inscription : Icy est le portrait de Clovis, roy de France,
premier roy du nom et premier roy chrestien en France.
Le tympan est surmonté d'arcs brisés torsadés. La moulure extérieure
du portail a servi de modèle pour la décoration de la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les colonnes
de gauche sont couronnées par deux chapiteaux sur lesquels sont scultpés
des musiciens. Scène profane ? Ils représenteraient alors des musiciens
qui accompagnaient les combats d'animaux, lors de la visite du roi Pépin.
Symbolisme religieux ? Ces personnages symboliseraient les futilités
du monde et les tentations que les moines laissaient à la porte pour entrer
recueillis dans l'abbatiale : à côté des musiciens, tourné vers
l'entrée, est sculpté un abbé, tenant dans ses mains une crosse et un livre,
peut-être la Règle de saint Benoît dont il est le gardien de l'application
en ces lieux. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au-dessus
du portail, s'ouvrent trois grandes fenêtres de style gothique. Au-dessus,
le pignon est percé d'un grand oculus décoré de bâtons brisés, et
surmonté d'une croix celtique placée au cours du XIXe siècle. A chaque
extrémité, deux contreforts soutiennent la façade.
Ce portail n'était emprunté autrefois que lors des grandes fêtes : Noël,
Pâques… Tous les autres jours, les moines passaient par l'une des deux portes,
de taille plus modeste, qui reliaient directement le cloître à l'église.
L'une se trouvait au fond de la nef, à l'emplacement actuel de la statue
du Christ après la flagellation ; l'autre existe toujours dans le transept
sud.
A l'entrée, le regard embrasse la nef dans
toute sa longueur. Les larges verrières et les murs, blanchis à la chaux
en 1818, la rendent très lumineuse. Cette nef date du XIIe siècle. Il ne
semble pas qu'il ait été prévu de voûter en pierre ce grand vaisseau, couvert
par une charpente lambrissée, en coque de bateau
renversée, dont la base est reliée par des entraits. Ce type de couverture
se retrouve dans de très nombreuses églises de la région. Elle remplace
depuis 1876, une voûte en plâtre, qui devait ressembler à celle de Notre-Dame
de Bethléem. |
|
|
|
|
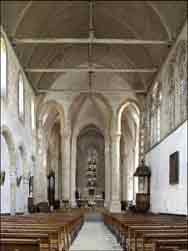 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vice
de forme dans les travaux de restauration
En 1876 l'architecte des monuments historiques a achevé des travaux
commencés en 1867. Tout le monde ne semble pas entièrement satisfait.
Cela est noté dans le compte rendu des délibérations du conseil
:
[…] tous les hivers lorsqu'il tombe de la neige, cette neige,
poussée par le vent s'amoncèle sur la voûte et donne, au dégel
une quantité d'eau telle que les assistants sont forcés de déserter
les places qu'ils occupent ordinairement sous cette voûte nouvellement
construite sur le plan et la direction de l'architecte des monuments
historiques ; que jamais on ne s'est plaint de l'inconvénient
signalé avant la démolition de l'ancienne voûte en plâtre que
le dit architecte a tenu de remplacer par une voûte en bardeaux
dont chaque joint donne passage à la neige fondue.
La municipalité refusa de payer les réparations nécessaires et
ce fut finalement la fabrique qui en assuma les frais, pour ne
pas provoquer la ruine de l'édifice.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Les
colonnes engagées dans le mur nord sont celles qui séparaient la nef du
bas-côté détruit : une grosse colonne alternait avec
deux petites colonnes jumelles baguées à mi-hauteur dont une seule demeure
visible. On trouve la même disposition à la collégiale de Champeaux, à Saint-Martin
d'Etampes ; le jumelage et le décor témoignent d'une influence de la cathédrale
de Sens. Au-dessus des arcades, les petites ouvertures, en arcs en plein
cintre, s'ouvraient au-dessus du collatéral. Sur le mur sud, les premières
travées ne comportent aucune ouverture, car le logis abbatial était autrefois
adossé à ce pan de mur : les bâtisseurs ne pouvaient donc pas y ouvrir une
fenêtre. Y est accroché un tableau représentant la Descente
de Croix, oeuvre du XVIIe siècle (école de Rubens).
L'ouverture murée qui abrite un Ecce
homo du XIVe siècle, communiquait autrefois
avec le cloître : c'était la porte empruntée régulièrement par les moines.
Dans les travées suivantes, le mur est percé de larges verrières en arcs
brisés, groupées par deux sous un arc de décharge. Dans l'ouverture centrale,
se trouve un vitrail du
début du XIVe siècle, le seul échappé à la ruine et à l'incendie de l'abbatiale
par les Anglais en 1428 : des motifs végétaux en grisaille relevés de jaune
d'argent avec des fermaillets de couleur. Il a été restauré en 1964, au
tympan surtout. Au-dessous, une peinture
sur bois représente saint Michel entouré de saint Benoît et de saint
Aldric en tenue d'archevêque. |
La
chaire située en haut de la nef date de 1777. Elle provient de l'église
Saint-Eloi, et fut placée là lorsque l'édifice fut rendu au culte catholique
au XIXe siècle. Elle fait face à un Christ
en bois du XVIIe siècle.
La particularité architecturale de cette abbatiale est la
coupole octogonale à
la croisée du transept. Cette structure est sans doute héritée
d'un premier bâtiment carolingien de plan centré construit à l'image
de la chapelle palatine dAix-la-Chapelle, comme l'église de Germigny-des-Prés.
Cet édifice primitif, dont subsiste encore, au pan postérieur droit,
un arc de pierres et de briques alternées, est devenu le chœur octogonal
d'une nouvelle église reconstruite par Aldric.
En 1606, Henri IV visitant l'abbaye se serait écrié en voyant cette
coupole : Comme c'est un habile homme qui l'a bâtie !
Les huit colonnes qui soutiennent la voûte ont conservé des traces
de peinture ocre et jaune. Les fûts sont surmontés de chapiteaux à crochets,
tous différents. Au-dessus, les tailloirs, de formes irrégulières, constituent
une base solide pour les arêtes de la voûte. L'ensemble paraît d'autant
plus imposant qu'il est surélevé, par rapport à la nef, d'une soixantaine
de centimètres. Les bâtisseurs ont dû s'adapter à la déclivité du terrain.
Cette disposition a fait supposer qu'il pourrait y avoir une crypte sous
la coupole ; en 1934, Jean Hubert réclamait que des fouilles soient entreprises
en affirmant dans une brochure sur l'abbatiale : J'ai même quelques raisons
de croire qu'il subsiste sous le dallage une crypte ou un étage aujourd'hui
souterrain et peut-être imparfaitement comblé. |
|
|
|
|
|
La symbolique du chiffre huit
Le chiffre huit est le chiffre de la limite de la vie humaine
(les sept âges de la vie) augmenté d'une unité. Au-delà du septième
jour, vient le huitième qui marque la vie des justes et la condamnation
des impies. Selon la symbolique chrétienne de saint Ambroise,
héritée de la symbolique antique, au chiffre 6, symbole de la
mort, s'oppose le chiffre 8, symbole de la résurrection. L'octogone
évoque la vie éternelle. Ainsi s'expliquent les plans octogonaux
des édifices religieux (Aix-la-Chapelle, Germigny-des-Prés, Ferrières…),
de certains clochers (celui de Cluny, par exemple), de baptistères.
Du XIe au XVIe siècle, la plupart des fonts baptismaux sont
de forme octogonale ou s'élèvent sur une rotonde à huit piliers.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le transept
sud a été largement remanié au XIXe siècle. Le retable contient
le tabernacle ; il est surmonté d'une statue du Sacré-Cœur. Sur la droite,
une porte, restaurée récemment, permettait d'accéder directement au cloître.
Sur la gauche, une statue de sainte Thérèse de Lisieux du début du XXe siècle
témoigne de la continuité du culte dans cet édifice.
Au-dessus de la statue, une grande ouverture donne sur la sacristie.
Elle permet d'apercevoir les peintures qui s'y trouvent et qui représentent
un jardin avec des frondaisons.
Cette partie de l'édifice n'est pas accessible au public. Elle est composée
de deux pièces. La première, la plus grande, s'orne de fresques du XVe siècle.
Une petite porte située sur la gauche ouvre sur la seconde, moins vaste
et plus basse de plafond : elle abrite un chapier qui renferme encore des
vêtements liturgiques brodés de fils d'or et d'argent, qui ont été utilisés
au XIXe et dans la première partie du XXe siècle.
Un autel en bois, placé à la croisée des transepts par l'abbé Joblin en
1963, marque l'emplacement occupé par le maître autel
des moines jusqu'en 1755. A cette date, il fut remplacé par un nouvel autel
en marbre, déplacé depuis vers l'abside. Cet autel est décoré par une
croix de Malte rappelant les liens qui unissaient l'ordre des chevaliers
de Rhodes, devenus chevaliers de Malte, à l'abbaye de Ferrières. |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A côté de
l'autel, sur la droite, dans le mur, trois
niches accueillaient les sièges du prêtre et de ses assistants. Au-dessus,
dans une baie aveugle, on distingue une fresque
du XIVe siècle : à gauche, le Christ vêtu d'un manteau rouge, la tête
surmontée du chrisme (lettres I et X, initiales de Jêsous Xristos) inscrit
dans l'auréole, remet les clefs de l'Église à saint Pierre, qui se tient
en face de lui.
Derrière le maître autel se trouve la tombe de Louis de Blanchefort. C'est le
seul des soixante-neuf abbés du monastère qui ait eu le privilège de reposer
dans un tombeau monumental. En 1505, quand Louis de Blanchefort s'éteint après
un règne de près de quarante ans, son frère, évêque de Senlis, et son neveu
et successeur Jean Pot commandent un tombeau. Il est orné de statues représentant
des vertus chrétiennes, dont le nom est gravé à leur pied. Sur le petit côté
à l'avant, on reconnaît les armoiries du défunt : d'or aux deux lions
passants léopardés de gueules. Sur le couvercle est gravée une épitaphe :
Ici repose frère Louis de Blanchefort, de très bonne mémoire, homme également
recommandable par sa piété et par sa charité, qui fut très digne abbé de ce
monastère ; le Christ retira son âme du monde, le III des calendes de mars MDC,
après qu'il l'eut administré pendant 42 ans.
Sur la dalle était alors un gisant représentant le défunt revêtu de ses habits
abbatiaux. L'ensemble fut d'abord placé en haut de la nef devant le maître autel.
Mais les restes de l'abbé ne devaient pas reposer en paix. En 1568, une troupe
de protestants dirigée par le prince de Condé (voir Une abbaye… Les guerres
de religion) pénètre dans le monastère et se livre au pillage et saccage
le tombeau. Après leur départ, les moines en remontent les restes dans le transept
sud. En 1847 ou 1850, par décision municipale, le tombeau est déposé à sa place
actuelle. Car les habitants des environs, croyant qu'il s'agissait de la tombe
de sainte Apolline, vierge et martyre, invoquée contre les maux de dents, avaient
pris l'habitude de venir gratter la tombe, pour en prélever des fragments, qu'ils
déposaient sur leurs mâchoires douloureuses !!! En le déplaçant au fond de l'édifice,
les édiles de la commune ont voulu le soustraire au zèle des fidèles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autour
du tombeau ont été regroupées les quelques stalles
qui restent du temps des moines. C'est, dit-on, Henri IV qui, après les
guerres de religion, aurait offert aux moines de nouvelles stalles, pour
remplacer celles détruites pendant les pillages de 1568 et 1569. Pour les
fabriquer il ordonna que l'on utilisât des arbres de la forêt royale voisine
de Paucourt. Deux stalles, plus claires que les autres, semblent d'époque
différente. Sur l'une d'elles (la stalle
de l'abbé ?), sont sculptées les armes de Ferrières surmontées de la
crosse et de la mitre, entourées de l'inscription : FERRAR (Ferraria)
OLIM ABB (abbatialis) ECCLES (ecclesia), ce qui signifie : Ferrières,
de temps immémorial, fut église abbatiale.
Sur une autre stalle, se trouvent les
armes de Blanchefort.
Les stalles étaient disposées en U dans la nef. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comment être à la fois debout et assis ?
Les moines passent un tiers du jour à chanter les louanges du Seigneur
dans l'abbatiale. Ils sont assis dans leur stalle au moment des lectures,
mais c'est en position debout qu'ils chantent les psaumes et récitent
les prières. Etre debout et immobile pendant de longues heures, c'est
fatiguant ! Pour y remédier les religieux relevaient leur siège, et
tout en restant debout ils pouvaient s'appuyer sur un second petit
siège appelé "miséricorde". Ce dispositif ingénieux leur permettait
de louer Dieu, des heures durant, debout… tout en étant assis !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |